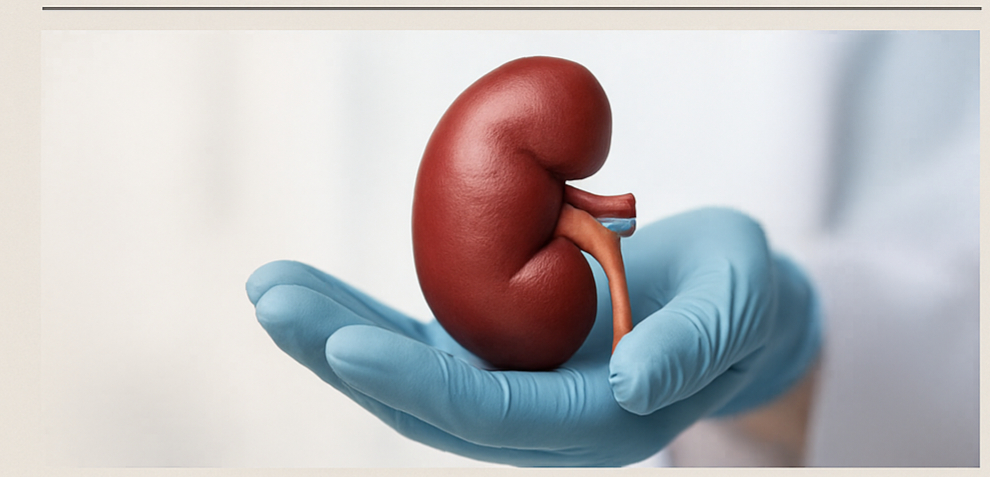Le 29 juillet 2025 restera gravé dans l’histoire médicale burkinabè. Pour la première fois, un rein a été greffé avec succès au CHU de Tengandogo. Ce progrès, fruit de l’engagement de nos chirurgiens et de l’appui de partenaires turcs, symbolise la capacité de notre pays à rompre avec la dépendance sanitaire. Mais au-delà de l’euphorie légitime, cette prouesse soulève des questions essentielles : durabilité, équité d’accès et formation locale.
—
Une prouesse à double tranchant
Oui, célébrons la performance de nos équipes : mener une intervention chirurgicale aussi complexe, coordonner donneuse et receveuse, maîtriser l’immunosuppression post-greffe et soigner dans un contexte de ressources limitées relève de l’exploit. Le soutien politique du Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim Traoré, a permis de débloquer des moyens, et c’est une première victoire contre la fuite en avant médicale vers l’étranger.
Pourtant, si la transplantation devient chaque semaine un fait divers, plutôt qu’un jalon durable, nous risquons l’épuisement de nos capacités financières et humaines. Un seul acte, même historique, ne suffit pas à construire un véritable programme national de greffe.
—
Les défis à relever
1. Former en masse : Une équipe de greffe, c’est des chirurgiens, certes, mais aussi des néphrologues, anesthésistes, infirmiers formés aux protocoles post-opératoires et aux complications infectieuses. Où sont les écoles de formation et les rotations spécialisées ?
2. Assurer l’accès équitable : Aujourd’hui, seule une patiente a bénéficié de ce service. Demain, qui pourra payer ? Le Burkina n’est pas un État-Providence riche : si cette offre reste réservée à celles et ceux qui ont les moyens, nous creuserons encore les inégalités de santé.
3. Sécuriser le don et la greffe : La solidarité familiale est louable, mais elle ne doit pas masquer les risques de pression sur les donneurs. Un cadre légal strict, des comités d’éthique indépendants et la gratuité de l’acte sont indispensables.
4. Garantir la pérennité : Le partenariat turc a été clé pour ce premier acte. Mais que se passera-t-il si, demain, ces experts ne peuvent plus assurer la relève ? Le CHU doit développer son autonomie technologique et logistique.
—
Vers une souveraineté sanitaire réelle
Le succès de Tengandogo est un signal fort : le Burkina peut et doit assumer ses ambitions médicales. Pour cela, il ne suffit pas d’un « one shot » médiatique. Il faut bâtir un plan décennal de transplantation : investissements dans les laboratoires, budget d’État dédié, formation continue, campagnes de sensibilisation au don d’organes et partenariats sud-sud.
La souveraineté sanitaire se mesure à notre capacité à répondre aux urgences, oui, mais aussi à prévenir, à planifier et à garantir un accès égalitaire à tous nos concitoyens. Il est temps de transformer cette victoire ponctuelle en fondation durable.
AISSEGNAIMON – Juriste-communicatrice
FasoInfos.com | Éditorial du lundi