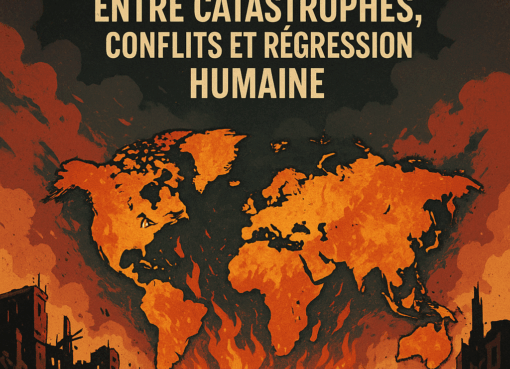Le Sahel brûle, mais personne ne crie.
Chaque jour, des villages disparaissent dans le silence. Des enfants sont arrachés à la vie, des femmes violées, des hommes exécutés sans procès. Et pourtant, les grandes puissances détournent le regard, trop occupées à défendre leurs intérêts ailleurs.
Du Mali au Burkina Faso, du Niger au Tchad, les peuples vivent entre deux feux : la terreur des groupes armés et l’indifférence d’un monde qui ne voit en eux que des statistiques.
Depuis 2012, lorsque le Mali a sombré dans le chaos après la rébellion du nord, des milliers de civils ont été tués ou déplacés. En 2015, les attaques contre le centre du Burkina Faso ont forcé plus de 100 000 personnes à fuir. En 2019, l’attaque de l’école de Kouré au Niger a coûté la vie à 20 enfants. Chaque drame aurait dû provoquer une réaction mondiale. Chaque drame aurait dû déclencher une mobilisation. Et pourtant, le monde a tourné la page.
Dans la lutte contre le terrorisme, les civils paient le tribut le plus lourd. Il est urgent de mettre en place des mesures concrètes pour protéger chaque homme, chaque femme, chaque enfant — à l’école, dans les champs, à la mosquée ou à l’église.
Les États sahéliens, affaiblis et isolés, crient à l’aide. L’aide internationale existe, mais elle reste souvent symbolique, confinée aux conférences et aux promesses non tenues. Comme le rappelait en 2018 un président africain à Abuja : « On ne peut plus parler d’Afrique comme d’un continent à secourir. Il faut agir, maintenant. » Ces mots sont restés lettre morte.
Où est passée la solidarité humaine ? Où sont les défenseurs autoproclamés des droits de l’homme quand des milliers d’enfants africains dorment chaque nuit dans la peur ?
La communauté internationale parle de démocratie, de droits humains, de paix. Mais lorsqu’il s’agit du Sahel, les discours se vident de sens. On promet de l’aide, on organise des sommets, on signe des déclarations… puis on passe à autre chose. Pendant ce temps, les populations locales paient le prix du silence et du désengagement.
La vérité est simple : la guerre perdure parce qu’elle sert les intérêts de quelques-uns. Quand le sang coule ailleurs, on appelle cela une tragédie. Quand il coule au Sahel, on parle de « problème régional ».
Les Africains ne demandent pas la pitié. Ils réclament la justice — celle qui protège la vie humaine, sans distinction de continent. Nelson Mandela disait : « Être libre, ce n’est pas seulement se libérer de ses chaînes ; c’est vivre d’une manière qui respecte et renforce la liberté des autres. »
Le terrorisme qui ravage le Sahel n’est pas seulement une menace africaine. C’est une menace contre l’humanité, la stabilité mondiale, la dignité humaine. Chaque village abandonné, chaque école brûlée, chaque femme violée est une défaite pour tous.
Les pays sahéliens ont besoin de plus qu’une compassion de façade. Ils exigent un soutien réel et durable :
– économique, pour reconstruire ce que la guerre a détruit ;
– logistique et militaire, pour protéger les civils ;
– diplomatique, pour redonner une voix aux peuples oubliés.
Face à cette situation, l’Alliance des États du Sahel (AES), regroupant le Mali, le Burkina Faso et le Niger, a décidé de prendre les choses en main. En juin 2024, elle a créé une Force unifiée (FU-AES) de 5 000 soldats pour lutter contre les groupes djihadistes. En parallèle, une Task Force anti-terroriste, basée à Ouahigouya au Burkina Faso, coordonne les efforts militaires et les échanges de renseignements.
Grâce à l’action de l’AES, les terroristes n’ont plus la force qu’ils avaient par le passé. Leurs positions sont fragilisées, leurs attaques moins meurtrières. Si le monde soutenait ces efforts à une échelle globale — logistique, financière, diplomatique — la fin de cette tragédie pourrait enfin être proche.
L’Afrique sahélienne ne demande pas la charité. Elle réclame justice, paix et dignité. Mais tant que le monde reste sourd, les terroristes parleront à sa place.
L’indifférence internationale est une faute morale. L’histoire jugera ceux qui ont su et n’ont rien fait. Kofi Annan rappelait : « Il n’y a pas de paix durable sans justice. » Ces mots doivent résonner aujourd’hui au Sahel.
Le Sahel ne doit pas mourir dans le silence. Il faut le dire, le répéter et le défendre — soutenir le Sahel, c’est défendre l’humanité tout entière.
AISSEGNAIMON — Juriste et éditorialiste engagée pour la justice et la dignité des peuples.
Fasoinfos.com — Éditorial du lundi