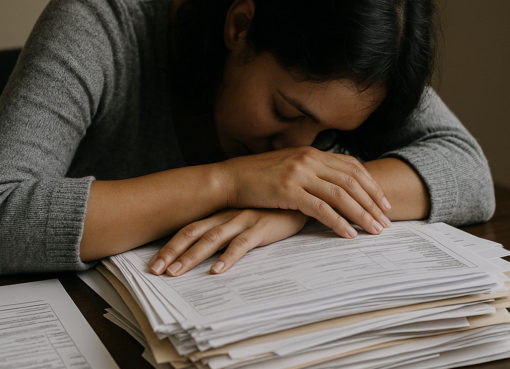Il est temps de transformer la sécurité routière en une véritable politique publique, structurée, moderne et juridiquement fondée.
1. Une loi claire, mais une application absente
Chaque année, au Burkina Faso, des milliers de vies sont fauchées par les accidents de la circulation. Pourtant, la loi existe déjà. Le Code de la route fixe les limites :
50 km/h en agglomération (Art. 51)
90 km/h hors agglomération (Art. 52)
Il impose aussi :
la circulation à droite (Art. 23)
la maîtrise du véhicule en tout temps (Art. 24)
le respect des signalisations (Art. 32)
l’obéissance aux injonctions des agents (Art. 35)
Les sanctions sont définies (Art. 96 à 104) :
motos : 6 000 FCFA
véhicules légers : 12 000 FCFA
poids lourds et transport : 25 000 FCFA
Et pour les infractions graves : immobilisation, fourrière ou suspension du permis (Art. 103–104).
Les textes sont là.
Ce qui manque, c’est le contrôle.
2. Installer des radars partout : une urgence nationale
Les Articles 51 et 52 définissent les vitesses.
Les Articles 96 à 104 définissent les sanctions.
Mais aucun système national de contrôle automatique n’existe.
C’est là que les radars deviennent indispensables.
Les radars fixes et mobiles permettent :
un contrôle permanent,
une égalité de traitement entre tous les usagers,
une baisse immédiate de la vitesse,
une prévention durable des drames.
La moto tue.
La voiture tue.
Le tricycle tue.
La loi doit s’appliquer à tous, sans exception.
3. Les communes ont le pouvoir et le devoir — d’agir
La Constitution de 1991 (Art. 142) et le Code général des collectivités (loi n°055-2004/AN) confient aux communes la gestion locale :
aménagement urbain (Art. 86)
gestion des voies et carrefours (Art. 87–88)
sécurité publique et protection des populations (Art. 90 & 94)
lutte contre les nuisances et l’insécurité (Art. 101)
Installer des radars entre clairement dans ces compétences, au même titre que :
les feux tricolores,
les ralentisseurs,
la signalisation,
l’organisation des voies.
La loi leur en donne le pouvoir.
La situation leur impose le devoir.
4. Un système autofinancé : simple, légal et durable
Le modèle est clair :
→ 1. Les communes financent l’installation.
Cela s’inscrit dans leurs missions d’aménagement et de sécurité.
→ 2. Les amendes financent l’entretien.
Les contraventions prévues par les Articles 96 à 104 peuvent alimenter un fonds communal de sécurité routière.
Résultat :
les radars se financent eux-mêmes.
Ce modèle existe ailleurs.
Il fonctionne.
Il sauve des vies.
5. La vitesse tue. La loi protège. Le contrôle sauve.
Selon les estimations de l’OMS, environ 6 300 personnes meurent chaque année sur les routes du Burkina Faso.
C’est une hécatombe — mais une hécatombe évitable.
Nous avons :
des lois claires,
des compétences locales,
un cadre juridique solide,
des sanctions définies,
la technologie disponible.
Ce qui manque, c’est le courage politique de tout mettre en place.
Installer des radars partout n’est pas un luxe.
C’est une obligation légale, un devoir moral et une nécessité nationale.
✍🏾 Par AISSEGNAIMON — Juriste et éditorialiste engagée pour la justice et la dignité des peuples.
Fasoinfos.com – Éditorial du lundi